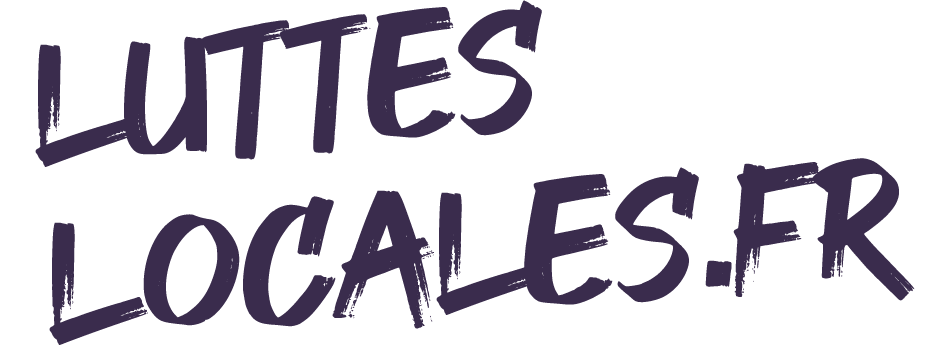S'outiller face à la répression
La répression c'est quoi ?
Face à la montée en puissance du rapport de force des collectifs en lutte et de leurs actions pour empêcher les projets imposés et polluants on entend souvent que la « répression s’intensifie », en effet l’État, les pouvoirs publics mettent en place de gros moyens administratifs, policiers et judiciaires pour éviter les perturbations dans l’implantation des projets d’aménagement du territoire. La répression peut donc aller de la simple surveillance passive à un réel harcèlement durable des militant.es.
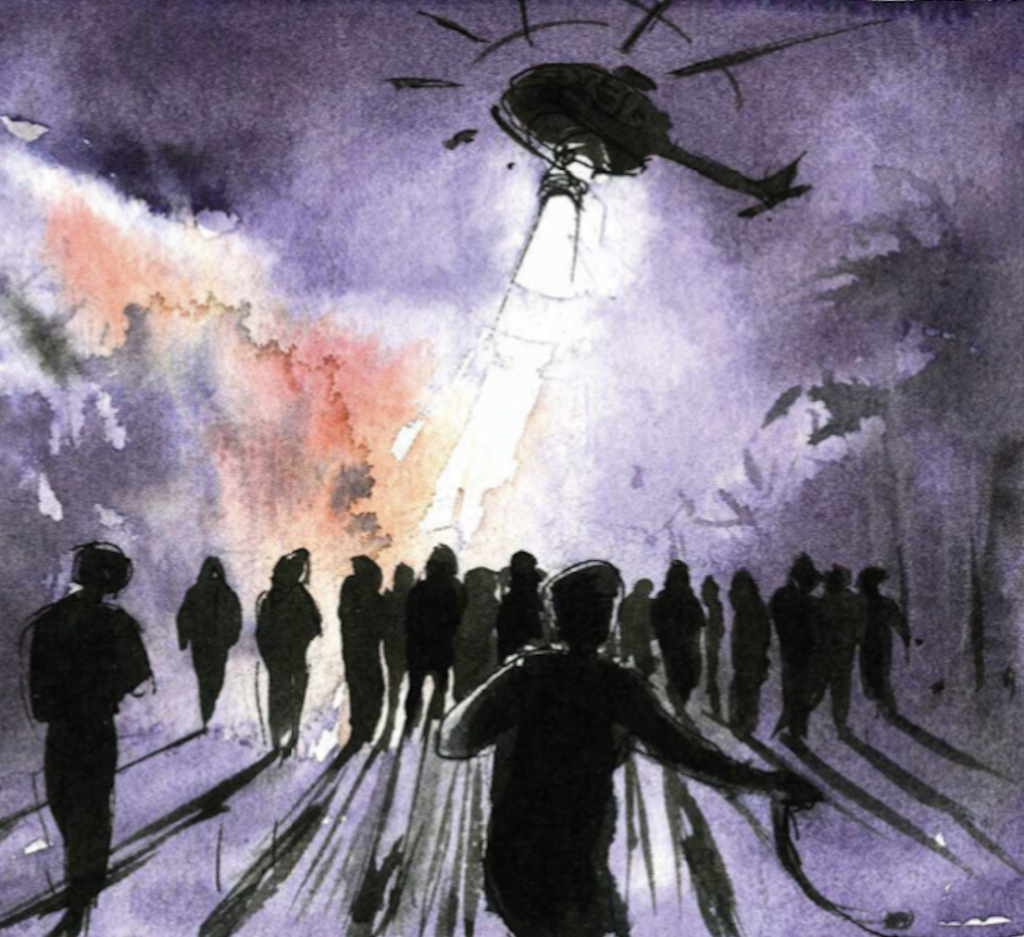
Même si vous avez l’impression que votre collectif n’a pas encore franchi la ligne rouge dans les actions de désobéissance, il est possible que les services de renseignement territoriaux ont déjà un oeil dessus. Il est donc important, dès la naissance du collectif de se protéger face à cette surveillance et à ses conséquences.
Se protéger et s’outiller lors d’actions militantes
Lors des actions et mobilisations les militant.es du collectif sont à risque, ils peuvent être contrôlé.es par les forces de l’ordre, et en fonction de l’action en cours, placé.es en garde à vue voire poursuivi.es lors de procès.
Il est donc essentiel d’avoir en tête ces risques et de se préparer aux différentes situations afin d’y réagir au mieux. Ainsi, afin de protéger les autres militant.es, et éviter de donner trop d’informations il est crucial d’en dire le moins possible et de garder le silence.
Différents briefings existent en fonction des situations, par exemple lors d’un contrôle d’identité, la loi n’oblige à donner que la petite identité (Nom, Prénom, Date et lieu de naissance, Nationalité, Domicile), lors d’une garde à vue la privation de liberté est liée à certains droit que peut exercer le ou la militant.e, des détails sur comment une garde à vue se déroule sont disponibles ici.
Même si ces notions sont peu réjouissantes il est essentiel de bien se préparer et informer les militant.es pour éviter les surprises et les erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences.
Ainsi avant de partir en action, assurez vous que le groupe est briefé, qu’il a en tête un.e avocat.e, de préférence sympathisante, à contacter et un.e proche qui pourra prévenir le reste du groupe militant ( ou que le groupe pourra prévenir). Il est aussi précieux de s’informer de ses droits, des risques et menaces précises qui pèsent sur les actions, des institutions policières et judiciaires susceptibles de les mettre en oeuvre.
Protéger le collectif au quotidien
Même si les menaces peuvent nous sembler disproportionnées par rapport aux actions menées par le collectif à un moment T, il est essentiel de se protéger et de protéger son collectif en amont de toutes activités qui pourraient déplaire aux pouvoirs publics, en effet, ce n’est pas posteriori que l’on pourra se protéger…
Il est donc essentiel d’adopter quelques réflexes par exemple :
- L’utilisation d’un pseudo en action, lors des réunions, peut éviter une identification trop aisée par les renseignements
- Correspondre avec une adresse mail sécurisée comme protonmail ou riseup (de préférence) qui ne contient pas nos prénoms et noms. Pour les informations les plus sensibles il s’agira de correspondre par mail avec des moyens de chiffrement
- Ne pas utiliser les sms ou les appels téléphoniques mais leur préférer des messageries cryptées telle que Signal téléchargeable sur les smartphones et ordinateur
- Ne pas prendre son téléphone en action ou en réunion pour éviter la géolocalisation des militant.es par « bornage » aux antennes téléphoniques
- Crypter son ordinateur ou un dossier sensible avec un logiciel comme Veracrypt et bien éteindre la machine avant d’aller dormir
- Utiliser le navigateur « Tor » afin de ne pas laisser de traces numériques des sites que vous visitez
- Eventuellement vous pouvez utiliser un VPN comme celui de riseup, il est à mettre en place avant toute navigation et s’assure de justement camoufler votre trace sur les sites visités
- En fonction des pratiques militantes utiliser une clé tails pour ne pas « laisser de traces » sur un ordinateur.
- S’astreindre ensemble, à rester discrets sur les informations sensibles et n’en parler que dans les temps dédiés et avec les personnes concernées : ne pas parler publiquement des actions passées ou futures, des personnes qui y prendraient part, en présence à des personnes qui n’ont pas absolument besoin de le savoir.
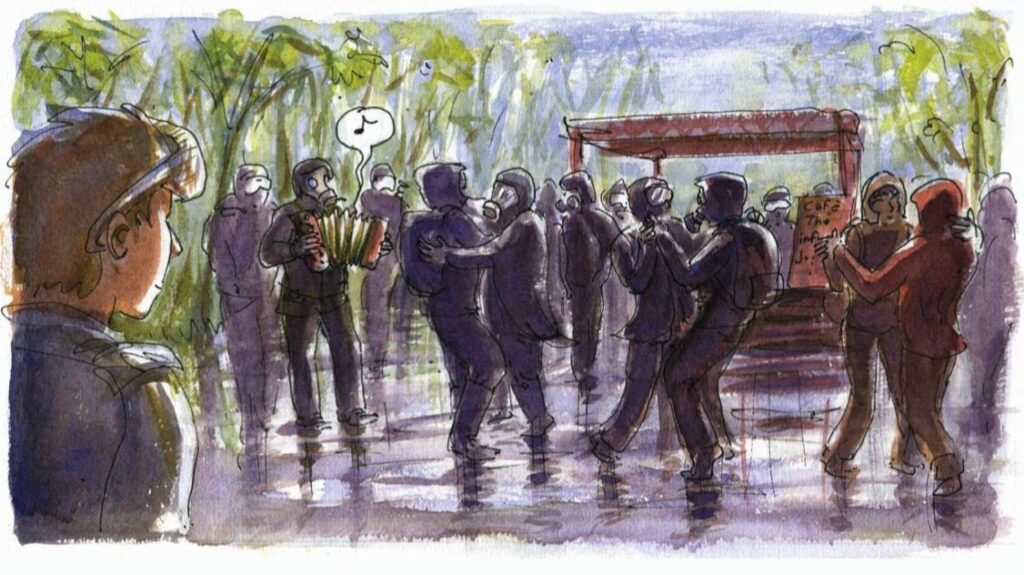
Même si ces consignes peuvent parfois nous sembler démesurées ce sont celles-ci même qui permettent de nous protéger maintenant et aussi dans le futur si des actions plus impressionnantes étaient planifiées par le collectif ou que le contexte répressif devait évoluer brutalement. Prendre les bons réflexes au départ et les mettre en place dès maintenant et éviter de le faire dans l’urgence permet de se concerter et d’en discuter ensemble afin de se mettre d’accord sur les pratiques communes du collectif.
Pour aller plus loin sur le sujet de la protection informatique, l’excellent guide d’Autodéfense numérique.
Rester solidaires
Qu’elle soit policière ou judiciaire, la répression ne se vit pas pour tout le monde de la même manière, selon les circonstances, les pressions qui sont exercées, les craintes des conséquences. Les violences et humiliations policières, les gardes à vue, les comparutions devant la justice peuvent affecter avec des intensités très différentes des personnes qui les vivraient en même temps, séparément ou ensemble. La répression crée de l’isolement.
Il est essentiel d’être attenti.ves à comment les autres ont vécu les confrontations avec police et justice, particulièrement dans l’entourage proche et au sein d’un groupe de personnes qui ont partagé une garde à vue ou qui sont inculpé.es ensemble. Prendre soin mais aussi créer un cadre de soutien et d’accompagnement collectif.
Il est possible de construire notamment des comités de soutien à partir et avec les proches, s’organiser pour porter et partager les charges mentales du suivi judiciaire et de la construction d’une défense, les charges financières des procédures avec les personnes poursuivi.es. Il est aussi possible de s’appuyer sur les groupes anti-répression qui sont constitués dans toute la France et reliés par le Réseau d’Autodéfense Juridique et de défense collective (RAJCOL) et sont habitués à assurer un accompagnement en concertation avec les inclupé.es et leurs soutiens.
Ces collectifs obéissent tous à des principes fondamentaux de solidarité face à la répression :
- La non-dissociation : face à la justice, malgré les disparités de vues et de parcours, d’expériences et de motivations qui peuvent co-exister au sein d’un groupe de personnes, il est important que la défense de l’une ne se fasse par au détriment d’une autre.
- La défense collective : les précédents judiciaires, les origines sociales, les charges différentes qui pèsent sur les différentes personnes interpellé.es ou poursuivies dans une même procédure peuvent créer des disparités importantes dans le jugement. La défense collective est une construction conjointe entre inculpé.es, avocat.es, entourage et groupes de soutien qui permet de rechercher ensemble, au consensus, la meilleure défense commune pour la meilleure issue au jugement pour tout.es.
- Un certain nombre d’avocat.es sympathisant.es sont habitué.es à défendre des militant.es dans toute la France, en lien et concertation avec des groupes de soutien juridique. Les choisir permet d’éviter des honoraires potentiellement très élevés, et de se prémunir de pratiques de défense qui n’obéiraient pas aux principes précédents et se feraient au détriment d’autres inculpé.es.